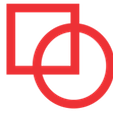45 – Préceptes du bouddhisme Mahayana KAI SILA VINAYA
Qu'est-ce le KAI ou les préceptes dans les enseignements du Bouddha Shakyamuni
Le terme Kai en japonais, communément traduit par Préceptes est fréquemment employé afin de désigner différents ensembles de préceptes bouddhiques instaurés au cours du développement des enseignements du bouddha Sakyamuni puis des écoles s’y référant, à travers l’Inde puis en Chine, sur plus de 2600 ans.
On peut dire qu’ils ont accompagné la création des écoles du Theravada, anciennement Hinayana (petit véhicule) puis la création des écoles du Mahayana (grand véhicule) en Inde, au cours des 1er et 2ème siècles, soit 500 à 700 ans après la mort du Bouddha Sakyamuni.
Plus particulièrement, les Kai avaient été substantiellement transformés avec la nouvelle ordination dite de Boddhisattva mise à l’honneur par l’école du Mahayana, le Grand Véhicule – dans le Theravada, on parlait plutôt des Arhats. Au préalable, un aperçu rapide des différents sens donnés au mot KAI s’avère nécessaire.
Histoire des KAI - Règles et préceptes éthiques VINAYA / SILA relatifs aux bouddhismes HINAYANA, MAHAYANA
Règles et Préceptes du Code Vinaya
Règles et Préceptes du Vinaya : Dans l’histoire du bouddhisme, les premiers Kai dits Règles du Vinaya datent de l’époque du bouddha Sakyamuni, ce terme désignait initialement les règles administratives de gestion de la vie communautaire de la sangha nomadique du bouddha. Certaines règles / KAI, furent instaurées par le Bouddha Sakyamuni lui-même, elles seront inscrites dans le code du Vinaya, lors de la tenue du premier concile de Vajraha, à la demande de Mahakashyapa. Ce code sera révisé et consigné, en Pâli ?, cent ans après, lors de la tenue du deuxième concile. On comptera respectivement 227 kai pour les bhikshus et 311 pour les bhikshus-ni, dans la tradition du Theravada. Parallèlement, les boddhisattva homme ou femme, recevaient respectivement 250 ou 358 dans la tradition dudit Mahayana fondé ultérieurement vers le 1er siècle et consolidés durant les siècles qui suivirent, plutôt en Chine qu’en Inde, sa terre natale.
SILA ou les préceptes naturels d'ordre éthique du trio des pratiques / entraînements (Sila, Samadhi, Prajna)
Avec le Mahayana, le terme Kai servira plutôt à désigner les Sila, préceptes naturels, qui sont plutôt d’ordre éthique ou moraux. Dorénavant, dans les enseignements, il s’agit moins d’évoquer les règles administratives et rigides liées au comportement au sein de la communauté. Le Mahayana tend plutôt à produire un guide de conduite éthique applicable à tous bouddhistes, laïcs ou religieux. Généralement, on en dénombre, 5, 8 ou 10[1], 5 pour l’homme ordinaire, 8 ou 10 pour les ordonnés Bodhisattva, les personnes peuvent désormais ne pas embrasser la vie nomadique du temps de Bouddha. L’adepte peut être laïc ou être ordonné, il peut vivre à domicile ou dans un temple, ces édifices s’érigeant rapidement dans les montagnes ou dans les villages. En fonction des écoles et maîtres, les laïcs, en fonction de leur capacité, choisissent 1 à 5 Kai, ainsi que la durée applicable consentie. Les religieux en reçoivent 8 ou 10, comme il est dit auparavant, les Kai peuvent être fixés par les différents écoles et institutions, et comme toujours, il n’y a ni de réelle rigidité ni de déterminisme, une règle d’or énoncée par le Bouddha Sakyamuni.
Au fur et à mesure, le terme Kai deviendra un élément du trio des 3 pratiques / entraînements essentiels du Mahayana (Kai, Samadhi, Prajna). Ces 3 pratiques sont également connues sous le nom des Six Paramitas.
Cette base des entraînements sera enseignée dans toutes les écoles du Mahayana. Leur respect empêche toute régression, le pratiquant ne retombe plus dans l’ignorance de départ qui aurait débuté alors un nouveau cycle des causes de renaissance. L’ensemble des six paramitas pour l’entraînement du corps-esprit mais également de la conscience est :
- Kai / Sila (quatre premiers paramitas)
- Le Don (en jap. Fuse)
- L’assiduité et la répétitivité
- La patience et la persévérance
- L’avancée continuelle sur la voie
- Samadhi ou Zanmai en japonais ou Esprit-Un (cinquième paramita) ou Concentration
- Sagesse Hannya (en jap. É)
Mais qu’est-ce que le SILA, un KAI éthique
Si le code Vinaya est utilisé pour gérer et administrer la vie communautaire de la Sangha, le Sila s’avère être un précepte naturel. Une direction éthique est donc donnée pour la guidance. On admet communément que pendant les 12 premières années depuis la constitution des sanghas de Bouddha, tout résidait en la conscience, plastique et dynamique.
Cependant, durant la 13ème année, un incident important survenait et le Bouddha était amené à établir alors une première règle de conduite, ou plutôt une convention, d’autres règles s’ensuivirent.
Bouddha se contentait de souhaiter « Svagata », la bienvenue aux nouveaux membres, conjointement avec la remise du kesa … M. Deshimaru, Le Vrai Zen
M. Deshimaru soulignait ici le principe de l’impermanence, l’enseignement du non-moi de Bouddha. Le moi étant non figé, le dharma l’est forcément, on ne peut demeurer ni dans le moi ni dans les dharmas, qui naissent en correspondance dans des conditions circonstancielles propres.
Les KAI dans l'histoire de la transmission du bouddhisme, de l'oral à l'écrit
Selon les travaux d’historiens, à l’époque en Inde, l’écrit n’est point mis à l’honneur, les paroles du Bouddha furent uniquement transmises oralement de personne à personne, de génération en génération, d’un dialecte régional à un autre. Peu d’écrits étaient disponibles bien que le Sanskrit, langue indo-aryenne existait à partir du XVè siècle av. J.-C. Ceci sera constaté par Faxian (vers 340-420) et Xuanzang (602-664), lors de leurs pérégrinations à la recherche des premiers textes du Dharma en Inde, au péril de leurs vies.
[show_more more= « En savoir plus » less= « ^ » color=“#ff0000”]
Par ailleurs, on ne peut déconsidérer le fait que le Bouddha ne parlait que le dialecte de son royaume Maghada (Sud du Nepal) dont le Sanskrit est fort éloigné, la fiabilité des traductions littéraires était donc plus qu’incertaine. Quant aux transmissions orales, initialement dans le dialecte de Maghada, elles s’élargiront au Pali. Au premier concile tenu à Vajraha après la mort du bouddha Sakyamuni, l’écrit qui existait ne fut toujours pas mis à contribution,
À partir du deuxième concile, soit 2 siècles après la mort du Bouddha Shakyamuni, le Theravada fut à l’origine de la compilation majeure de l’ensemble du Canon Pali appelé Tripitaka.
Le Tripitaka sera composé des trois volumes: Vinaya-pitaka, le Sutta-pitaka et l’Abiddhamma-pitaka,
Cependant, les premiers schismes prirent place donnant naissance à 18 écoles majeures, ad minima.
Ce sera seulement avec la transmission d’Inde en Chine qui débuta aux 1er et 2ème siècle qu’on accèdera aux travaux gigantesques de Kumarajiva (vers 350-409), moine de la région de Koutcha (Asie centrale, actuelle province Xinjiang), plus de 1440 ouvrages, soit 5586 volumes seront rendus disponibles. La collecte des écrits, les travaux auront perduré pendant plus de mille ans et se poursuivent encore jusqu’à maintenant.
Plus particulièrement, l’esprit des règles subira une profonde transformation avec le dharma de Shin Ku, le principe de la vacuité originelle et l’instauration du Bodhisattva par les écoles du Mahayana.
[/show_more]
Pour plus de précisions sur cette période historique, se référer aux enseignements en vietnamien du maître zen Thich Nhat Hanh ainsi qu’aux ouvrages de référence d’Oxford.
L'énoncé des 5, 8, 10 KAI préceptes bouddhiques réceptionnés lors des ordinations
Habituellement, le bouddhiste laïc résidant à domicile qui n’a pas prononcé des vœux religieux, réceptionne 5 Kai SILA, c’est le plus petit dénominateur commun entre laïc et ordonné, que ce dernier vive au temple ou à domicile. Ces 5 vœux appelés Panca-Sila sont les suivant :
- Ne pas tuer
- Ne pas prononcer de paroles qui causent du tort à autrui
- Ne pas voler
- Ne pas avoir de pratiques sexuelles non appropriées
- Ne pas nuire à son corps
Selon la tradition Mahayana, à ces vœux de base s’ajoutent 5 autres. Ces 10 vœux s’appliquent essentiellement aux Shami, c.à.d. religieux et religieuses en stage.
- Ne pas manger après 12h
- Ne pas trop se distraire dans les arts : danse, chant, musique …
- Ne pas se maquiller, porter de parfum, se parer de bijoux
- Ne pas dormir sur des lits luxueux
- Ne pas recevoir de l’argent, des biens précieux en or ou en argent
Prise de Refuge et Jukai : De nos jours, habituellement, les 5 vœux de base sont reçus lors de l’ordination de « prise de refuge » ou « Jukai », lit. Réception des Kai, pour une période déterminée. Ces prises de vœux ont généralement lieu, le 1er et le 15 de chaque mois mais aussi les 8 et les 21, toujours selon le calendrier lunaire.
Les 10 vœux du Bodhissatva : Ces vœux sont réceptionnés lors de l’ordination de Bodhisattva, dans la tradition du Mahayana. Ils peuvent être différents, la détermination spécifique est fixée par les écoles et maîtres.
La liste des huit lois dans les travaux de l'historien japonais Daisaku Ikeda
Lorsque le mouvement du Mahayana se développa aux alentours du 1er siècle, en Inde puis en Chine, les règles et interdictions fixes représentées par les Kai furent progressivement remplacés par la pratique des Paramitas. En effet, les laïcs mais aussi les religieux bouddhistes ne désiraient plus vivre en nomades mais souhaitaient pratiquer directement dans la vie sociale, le renoncement et l’ascèse prônés par le bouddhisme primitif ne convenaient plus. Religieux et laïcs se sédentarisent, s’installant à domicile dans un temple, le respect de nouvelles règles plus adaptée à un code sociétal fut encouragé.
Tout au début, le Mahayana a conservé les Kai du Theravada mais finira par les rendre plus libres et plus profonds. Ainsi, le bodhisattva pourra désormais s’appuyer sur les vœux et s’entraîner. À partir du trio (Sila, Samadhi, Prajna), la conscience de l’adepte bouddhiste est promise alors à ne plus régresser.
Les écrits seront rédigés à partir du sutra Brahmajāla, il se compose des 6 paramitas appelés aussi le trio de pratiques Sikkha-Pada (Kai, Samadhi, Prajna), les pratiques pures, réelles, infinies, exemptes d’illusions, de préjugés, de figurations mentales, etc …
Le bouddha Sakyamuni énonça jadis : « La pratique du Samadhi associée aux Sila et à la Sagesse Prajna amène à une grande perfection.
La pratique de Zazen avec l’esprit Prajna de la grande sagesse, ne fait plus chuter et retomber dans la première ignorance.
Avec la révision des Sila, selon le Sutra de Vimalakirti, le bodhisattva est encouragé à prendre modèle sur une liste de « huit lois » dont l’une des traductions figure dans l’ouvrage du grand historien japonais Daisaku Ikeda :
- Procurant des bienfaits aux gens de ce monde, il est préférable de n’en attendre aucune récompense.
- Il faudrait pouvoir considérer comme siennes les souffrances de tous les êtres.
- Tout mérite acquis, vous devriez l’imputer entièrement aux autres.
- Vous devriez considérer tous les êtres comme vos égaux, sans distinction, vous incliner devant eux, et ne nourrir dans votre esprit aucune forme d’hostilité à leur encontre.
- Il ne faudrait jamais nourrir de soupçons à l’égard d’un sutra jamais entendu auparavant ; et éviter toute dispute avec les adeptes de l’Hinayana, l’école initiale du bouddhisme primitif.
- Vous ne devriez pas être jaloux des dons que d’autres personnes reçoivent, ni vous vanter de vos propres gains, mais conserver le contrôle de votre propre esprit.
- Il faudrait réfléchir à vos propres erreurs, plutôt que de parler des fautes des autres.
- Vous devriez, en toutes circonstances, conserver une détermination inébranlable et vous efforcer d’acquérir des mérites de toutes sortes.
[1] Ces règles sont quasiment uniformisées par les différentes institutions religieuses depuis. Elles sont reçues par les adeptes lors des cérémonies dites de « Prise de refuge » dans l’Asie du Sud-Est, ou de « Jukai » (réception des Kai) dans les différentes écoles de zen, au Japon.
[2] Voir La Pérégrination vers l’Ouest, Collection de la Pléiade, Ed. Gallimard